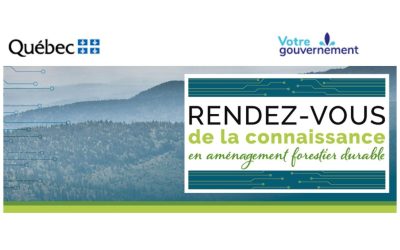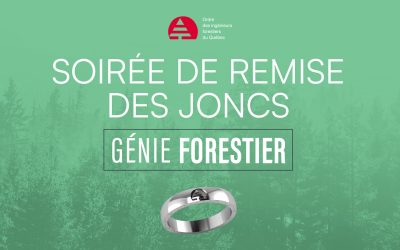Calendrier des activités et formations
22 et 23 janvier 2026 – 2e Édition – Colloque hybride Milieu forestier : Actions concertées pour maintenir la biodiversité
Milieu forestier : Actions concertées pour maintenir la biodiversitéPrésentiel et virtuel22 et 23 janvier 2026Hôtel Le Concorde - Québec Nous traversons une période charnière pour l’avenir de nos...
27 janvier 2026- Café conférence forestier
GéoSylva : un nouvel outil pour visualiser en 3D les effets de l'aménagement forestier sur le paysage Mardi 27 janvier 2026 - 7h30 à 9h00Présentiel : Salle Gilbert-Tardif (2320-2330)Pavillon...
Tournée des régions du président
Tournée des régions du président - Échangeons sur notre profession Patrick Pineault, ing.f.Ordre des ingénieurs forestiers du QuébecPrésentiel Le président de l’Ordre des ingénieurs forestiers du...
16 février 2026 – Déontologie et pratique professionnelle
Formation en salle • 16 février 2026 – Québec Cette formation est admissible à 6,5 heures de formation structurée. La formation « Déontologie et les normes de pratique professionnelle » porte...
17 février 2026 – Rendez-vous de la connaissance en aménagement forestier durable
Rendez-vous de la connaissance en aménagement forestier durable - 17 février 2026 Nos activités de transfert de connaissances virtuelles, gratuites et ouvertes à tous, reprennent de plus belle cet...
17 mars 2026 – Rendez-vous de la connaissance en aménagement forestier durable
Rendez-vous de la connaissance en aménagement forestier durable - 17 mars 2026 Nos activités de transfert de connaissances virtuelles, gratuites et ouvertes à tous, reprennent de plus belle cet...
27 mars 2026 – Soirée de Remise des joncs
Soirée de Remise des joncs 2026 - 27 mars 2026 La traditionnelle Soirée de remise des joncs par l’Ordre des ingénieurs forestiers du Québec se tiendra le 27 mars prochain, à l’Hôtel Plaza de Québec....
14 avril 2026 – Rendez-vous de la connaissance en aménagement forestier durable
Rendez-vous de la connaissance en aménagement forestier durable - 14 avril 2026 Nos activités de transfert de connaissances virtuelles, gratuites et ouvertes à tous, reprennent de plus belle cet...
Conférence canadienne sur la forêt urbaine 2026
Conférence canadienne sur la forêt urbaine 2026 - 13 au 16 octobre 2026 À mettre à votre agenda La Ville de Québec est fière d’accueillir la Conférence canadienne sur la forêt urbaine, en...